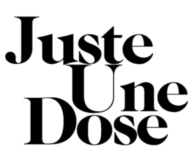Il y a un an très exactement, après avoir pris l’avion en quasi catastrophe pour Toulouse, je me rendais aux funérailles de ma grand-mère maternelle, Marthe. Un 15 avril au goût amer, dont les souvenirs restent particulièrement exacts dans mon esprit, moi qui ai pourtant tendance à particulièrement tout oublier.
Il faisait très chaud, je me souviens d’une quantité incroyable de fleurs et de messages, de regards plein d’empathie de personnes que je ne connaissais pas, de ce corps inanimé que je ne reconnaissais pas non plus, de cette lourdeur dans la gorge et l’estomac, des yeux rouges et bouffis. Heureusement, je n’avais pas mis de mascara.
Durant la cérémonie religieuse, j’avais lu ces quelques mots que j’avais écrits le soir précédent.
« Même si l’on sait que le temps fait son œuvre, même si l’on sait que les semaines, les mois et les années passeront, l’on s’accroche à l’idée que cette emprise nous laissera à nous et à nous seuls, quelques jours de répit. Quelques jours pour te voir, pour échanger à nouveau quelques mots sans importance, que l’on oubliera probablement de retour à nos habitudes.
Et puis un jour ces mots sont les derniers. Lorsque l’on les prononce, lorsque l’on les écrit, personne ne se doute – pas même toi mamie- qu’il faudra à jamais les chérir.
Alors on les oublie ces mots sans importance et seuls restent à jamais – ou presque, nous ne sommes qu’humains après tout – des souvenirs anciens et flous où tu dessinais sur mes doigts des personnages fabuleux qui s’animaient.
Tant d’histoires d’êtres aimés aussi, ces anciens que nous n’avons pas connu, que tu nous contais assise sur un banc, parfois l’air grave, parfois l’air léger mais réussissant toujours à nous emporter à une époque déjà trop lointaine. Souvent c’était la guerre.
Un récit forcément difficile mais dont la fin heureuse permettait toujours de sécher cette larme qui roulait sur ta joue.
C’était, je crois, les seuls moments où tu te laissais gagner par l’émotion au point de ne pouvoir la contenir. Tu étais ce que l’on appelle une femme forte, de ce genre de femme qui travaille sans répit et sans espérer de récompense, pour seulement profiter d’une famille aimante à l’aube de ta vie.
Souvent tu disais qu’elle n’avait pas toujours été facile mais que l’être humain avait cette douce capacité d’oublier lentement les moins bons souvenirs.
Ne restait alors que cette épicerie, où tu aimais continuer à passer un peu de ton temps, ce lieu qui fut toute ta vie et qui fut bien sûr aussi la nôtre.
Comme tu t’en doutes et comme tant d’autres mamie, j’ai du mal à m’imaginer que tu nous regarderais maintenant de là-haut.
En réalité, je crois plutôt que tu es ici ; un peu de toi dans tes rosiers chéris, un peu de toi dans ta maison vieillie, un peu de toi dans ce paysage que tu aimais tendrement et qui sans toi n’a plus les mêmes couleurs.
J’aurais aimé te serrer dans mes bras mais d’autres sont peut-être en train de le faire pour moi.
Je ne pourrais alors serrer que ces lettres reçues de toi, ces lettres où ta plume s’animait toujours si bien ; c’était surement ton plus beau secret.
Je voudrais terminer en la citant, dans une lettre du 25 juin 2011 :
J’implore toujours cette force au-dessus de nous que l’on appelle Dieu, ou est-ce ceux que l’on a aimé qui nous aident depuis là- haut ; peu importe, lorsque tout va bien, je dis merci au ciel »
0